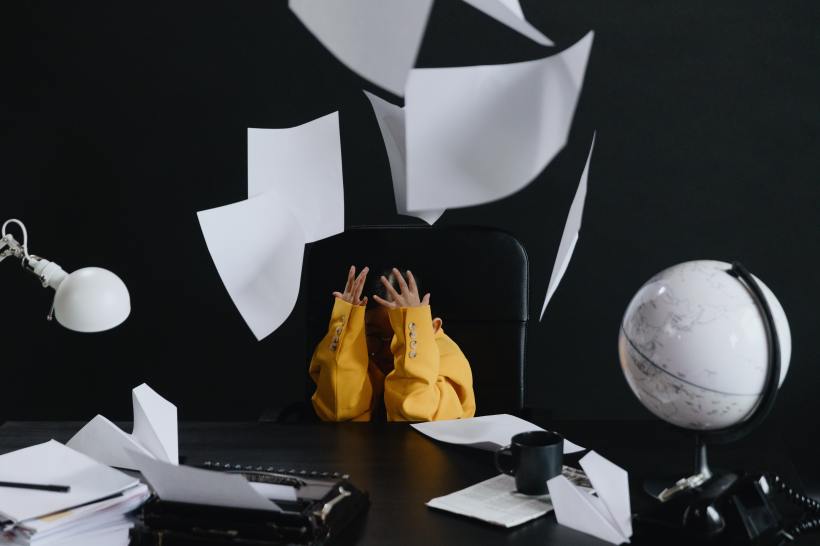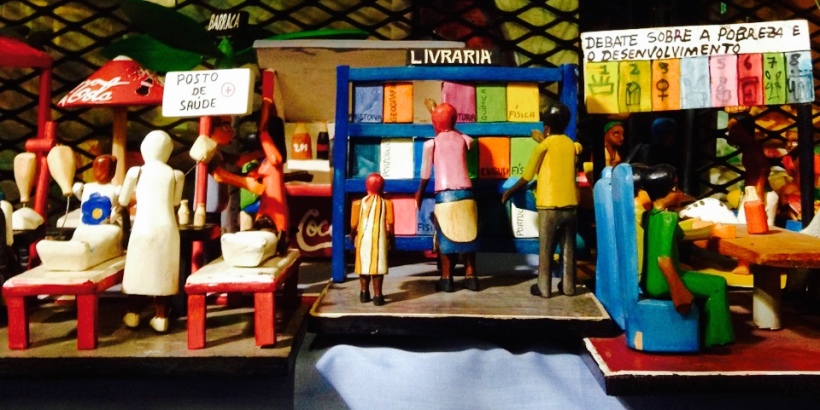Qui ne connaît pas l’histoire est destiné à en reproduire les errements. Depuis quelque temps, l’importance à accorder à l’histoire, à celle qu’on se raconte en tant que personne, peuple, nation, et comme membres du genre humain me paraît de plus en plus saillante. Face à l’impératif d’indignation perpétuelle, nourri par une immédiateté serinée à tout bout de champ par les chaînes d’information en continu et les réseaux sociaux, face aux injonctions de choisir son camp, de figer une fois pour toute le bien et le mal dans un affrontement manichéen, se replonger dans l’histoire, est l’un des remèdes qui apaisent, et incitent à plus de modestie dans les propos, les jugements et les comportements.
Le mois dernier, avec ma mère, nous avons suivi un parcours guidé dans le château de Versailles sur les commandes royales aux peintres de la famille Vernet (Joseph, Carle et Horace), dans le cadre de la rétrospective sur l’oeuvre du dernier. Cela faisait bien dix ans que je n’avais pas mis les pieds dans le château, et lors de mes visites précédentes, j’avais plutôt privilégié le Versailles de l’Ancien Régime.
J’avais oublié que Louis Philippe avait eu le projet de faire de ce palais alors grandiose et délaissé au début de son règne, le premier musée où le peuple français pourrait retrouver et admirer son histoire. Ce musée à “toutes les gloires de France” exigea de transformer nombre d’anciens appartements de la cour en galeries accueillant des peintures monumentales représentant différentes époques de l’histoire de France, de Clovis et Clotilde à sa majesté Louis Philippe, en passant par l’Empire. Pour ce projet gigantesque, un concours fut organisé, des centaines de toiles réalisées dans des galeries organisées à la fois par ordre chronologique, et par thème. Ainsi, il y a des galeries sur le Moyen Âge, des galeries sur les grandes batailles, et des salles africaines revenant sur la récente colonisation de ce continent avec notamment les exploits du Duc d’Aumalle, fils du roi, en Algérie.
Des peintures de Carle et Horace Vernet, assez habiles pour être bien en cour, quelle que soit l’époque, figurent bien sûr dans ce parcours de l’histoire. La peinture historique, vous ne l’ignorez pas, fut un genre en soi qui n’était second qu’à la peinture religieuse, les artistes européens ayant eu pour mission de glorifier les Dieux avant de glorifier les hommes. Nous sommes ressorties enchantées de ce parcours, nous n’y avons pas vu que des chefs d’oeuvre, loin s’en faut, mais le projet en lui même en impose, et il suscite une réflexion sur ce que c’est que l’histoire, comment on choisit de la représenter, qui sont les absents, quels messages persistent après la visite, etc.
Ainsi, la prise de la smala d’Abd el Kader, d’Horace Vernet, aux proportion gigantesques, puisqu’elle mesure 23 mètres de long (!) n’est pas, à proprement parler, un chef d’oeuvre. Il faut s’y reprendre à plusieurs fois pour embrasser l’ensemble, le mélange de peinture de guerre, d’orientalisme, de grandiloquence, et la multitude de scènes dans la scène peut donner le tournis. Les futurs colonisés sont à la limite de la caricature, avec des visages grimaçants.Elle fait forte impression par ses proportions, devant lesquelles l’on se sent minuscule.
J’ai aimé voir cette toile et ces salles consacrées à la conquête de l’Afrique parce que sans ces faits historiques, notre histoire familiale aurait pu ne pas être. Ma mère, vietnamienne élevée au Sénégal, n’y serait pas née, et je n’aurais pas passé mon enfance sur ce continent qui m’a profondément marquée. De mes premières années en Algérie, il me reste très peu de souvenirs, hormis les tortues de la forêt de Courbet, qui a changé de nom depuis. Nombre de nos compatriotes ont, comme moi, des histoires familiales forgées par cette partie de l’histoire, bien moins glorieuse que ne l’envisageait ses commanditaires.
Aujourd’hui, alors que la colonisation fait désormais partie des passages les plus contestés de l’histoire de France, la peinture peut choquer par son anachronisme triomphant, infliger un camouflet aux bonnes âmes qui pourraient vouloir que l’on exile dans les bas-fonds des réserves du musée, voire que l’on brûle cette croûte représentant une des taches sur l’histoire de l’humanité.
On peut aussi sourire de la vanité que cette peinture représente, de la relativité des valeurs selon les époques. Et s’interroger. Que nous montrent ces tableaux, qui voulaient inculquer au peuple le sens et la fierté de l’histoire de France? Une vision stéréotypée des peuples à coloniser, et une glorification des vainqueurs. L’histoire telle qu’on la concevait alors, de Hastings au siège de Constantine, ce sont d’abord des conquêtes militaires, rarement des défaites.
Alors que notre guide nous entraînait dans les galeries des batailles, je fis remarquer à une visiteuse de notre groupe le fait qu’en dehors de Jeanne d’Arc, il n’y aurait sans doute aucune autre femme au centre des tableaux exposés. “C’est normal. Les femmes ne sont jamais des chefs de guerre” me répondit-elle, “elles préférent la paix”. Je lui rétorquai qu’à mon sens il n’y avait pas de pacifisme inhérent au sexe féminin, mais qu’historiquement, dans la division sexuelle du travail, les hommes faisaient la guerre, et les femmes fournissaient la chair à canon et en étaient de ce fait exemptées. C’est une façon bizarre d’envisager les choses me répondit-elle. Comme je la renvoyais à Vladimir Poutine et à sa récente politique pour stimuler la natalité en Russie. Elle me répondit sèchement : “écoutez, je suis militaire et d’origine russe!”. J’évitai ensuite de lui adresser la parole.
J’en pris pour mon grade. J’avais oublié que l’histoire est aussi une affaire de point de vue, et que les points de vue diffèrent forcément. En tant que quinquagénaire française, sociologue et féministe, l’absence criante de femmes était le trait qui me frappait le plus. En tant que militaire étrangère, le côté non mixte – si l’on exclut les cantinières et autres fournisseuses de confort, rarement dépeintes- des tableaux intéressait moins mon interlocutrice que les batailles dépeintes, dont les noms devaient résonner avec ce qu’elle avait lu dans des ouvrages d’histoire militaire. Sa vision était aussi légitime que la mienne. Et nous aurions sans doute pu engager un dialogue intéressant.
“Qu’importe de violer l’histoire, si on lui fait de beaux enfants” disait Alexandre Dumas. Ce musée des gloires de France est un parti-pris sur l’histoire, aussi sujet à caution que les romans de Dumas, ou La légende des siècles de Victor Hugo “Waterloo, morne plaine…” *. Le mérite de ce musée, comme de tous les musées à prétention historique, c’est d’offrir un condensé de la pensée d’une époque, et de la vision de son promoteur. Celle de Louis Philippe dans les années 1830 était celle d’une France qui se voyait conquérante, apportant la lumière de la civilisation qu’elle avait entretenue depuis le baptême de Clovis jusque dans ces terres d’Afrique dont elle ne comprenait pas les coutumes.
C’est cependant une vision sur laquelle s’est construit tout un imaginaire qu’on aurait tort d’ignorer. Elle a été amendée par la révolution de 1848, le second empire, la guerre de 1870, et toute l’histoire du vingtième siècle. De nouvelles visions se sont ajoutées aux précédentes, les manuels des écoliers ont vu varier les contours de la France, et le récit, le “roman national” qui y était attaché. N’est-ce pas en participant à cette conversation que nous pourrons répondre aux défis que nous pose le vingt-et-unième siècle, plutôt qu’en nous lançant des invectives sur les réseaux sociaux?
* déformé par Goscinny en “Waterzoï, morne plat” pour Astérix chez les belges